- Détails
Dans la douce éclosion du printemps, l'âme s'éveille à la promesse de renouveau, tandis que le corps se déleste des lourdeurs hivernales. Sous le ciel éclatant, chaque bourgeon qui s'ouvre résonne comme une invitation à la vitalité retrouvée. Les bienfaits du printemps s'entremêlent harmonieusement, enveloppant le corps de douces caresses et l'esprit de pensées lumineuses.

Au rythme cadencé des fleurs écloses, le printemps offre une véritable cure de vitalité. Les journées s'allongent, incitant à une plus grande activité physique, tandis que l'air embaumé de senteurs fraîches stimule les sens engourdis. Les promenades dans la nature se transforment en véritables séances de méditation, apaisant l'esprit et nourrissant l'âme de beauté.
La lumière du printemps, douce et réconfortante, agit comme un baume sur les maux de l'âme. Les rayons du soleil caressent la peau, libérant des endorphines et réveillant la joie enfouie au plus profond de notre être. Dans ce ballet incessant de lumière et d'ombre, le printemps réveille en nous une harmonie perdue, rétablissant l'équilibre entre le corps et l'esprit.
Enfin, le printemps offre une bouffée d'optimisme et d'espoir après les longs mois d'hiver. Chaque jour qui s'éveille est une promesse de renouveau, une invitation à saisir pleinement les opportunités qui se présentent à nous. Dans cette saison de renaissance, le corps se régénère et l'esprit s'élève, prêts à embrasser la vie avec toute la passion qui nous anime.
Profitez tous de ce nouvel éveil de la nature.
Christian Cordt-Moller, Pharmacien indépendant FPH / propriétaire
- Détails
Traiter les allergies saisonnières, telles que le rhume des foins, les picotements des yeux, les démangeaisons et les éternuements, va au-delà de la simple gestion des symptômes physiques. Cela nécessite une approche globale, mêlant soins physiques et bien-être mental. Adopter une philosophie de vie équilibrée peut contribuer à atténuer les effets de ces allergies et à améliorer la qualité de vie. Voici quelques principes philosophiques à considérer :

Acceptation de la Nature : Les allergies saisonnières sont souvent une réponse naturelle à des facteurs environnementaux. Accepter cette réalité permet de cultiver une attitude de compréhension envers la complexité du monde naturel et de ses interactions avec notre santé.
Pratique de la Pleine Conscience : La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans le moment. Appliquée aux allergies saisonnières, cela signifie être conscient des symptômes sans les laisser dominer chaque pensée. La pleine conscience peut aider à réduire le stress lié aux allergies et à améliorer la qualité de vie.
Adaptation à l'Environnement : Plutôt que de lutter constamment contre les éléments extérieurs, envisagez des adaptations positives à votre environnement. Utilisez des filtres à air, maintenez une propreté intérieure, et évitez les activités en plein air pendant les pics de pollen pour minimiser l’exposition. Pensez également à vous doucher, vous laver les cheveux, vous laver les mains et changer de vêtements fréquemment, éviter d’ouvrir les fenêtres pendant la journée, ne pas faire sécher le linge dehors, rouler fenêtres fermées en voiture, faire le ménage plus régulièrement.
Équilibre dans l'Hygiène de Vie : Maintenir un équilibre dans l'alimentation, l'exercice physique et le sommeil peut renforcer le système immunitaire et réduire la sensibilité aux allergènes. Une alimentation saine et équilibrée peut également avoir des propriétés anti-inflammatoires.
Relations Positives avec le Corps : Cultiver une relation positive avec son propre corps est essentiel. Prenez soin de vous, écoutez les signaux de votre corps, et consultez des professionnels de la santé pour des conseils appropriés.
Engagement envers la Prévention : Au lieu de réagir uniquement aux symptômes, engagez-vous à prévenir les allergies saisonnières autant que possible. Cela peut inclure des consultations régulières avec des spécialistes - votre médecin ou votre pharmacien -, des changements d’environnement - allez plus souvent à la montagne lors des pics polliniques -, et des méthodes de prévention naturelles - huile essentielle d’estragon, huile de cumin noir, les probiotiques et prébiotiques, l’homéopathie - Poumon-Histamine, Allium Cepa, Pollens -, les oligo-éléments, zinc, manganèse et magnésium, la vitamine C, le cassis en gammathérapie, les oeufs de cailles en comprimés, la vitamine D.
Gratitude pour la Santé : Pratiquer la gratitude pour les jours où les symptômes sont moins prononcés peut aider à maintenir une perspective positive malgré les défis que posent les allergies saisonnières.
En adoptant une philosophie de vie qui intègre ces principes, il est possible de transcender les limitations imposées par les allergies saisonnières et de vivre pleinement malgré ces défis. La clé réside dans l'harmonisation entre la prise en charge physique et le bien-être mental, créant ainsi un équilibre qui favorise une vie épanouissante.
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails
Retrouver une bonne forme et perdre quelques kilos superflus ne devrait pas être considéré comme une simple quête de la minceur, mais plutôt comme une démarche visant à cultiver l'harmonie entre le corps et l'esprit. La philosophie de ce processus repose sur l'idée de prendre soin de soi-même de manière holistique, en reconnaissant que la santé physique et émotionnelle est interconnectée.

Loin des régimes éphémères et des approches draconiennes, adopter une perspective philosophique pour retrouver sa meilleure forme suggère une transition vers un mode de vie équilibré et durable. Il s'agit de cultiver une relation bienveillante avec son corps, en respectant ses besoins fondamentaux.
Le voyage vers une meilleure santé commence par une alimentation consciente, non pas dictée par des règles strictes, mais par une écoute attentive des signaux de son propre corps. En embrassant une alimentation équilibrée et variée, on honore la diversité des nutriments essentiels, reconnaissant que chaque repas est une opportunité de nourrir tant le corps que l'esprit.
L'activité physique, loin d'être perçue comme une obligation, devient une célébration du mouvement et de la vitalité. Que ce soit à travers la danse, la marche contemplative ou toute autre pratique qui apporte de la joie, l'exercice devient un moyen d'explorer les capacités du corps plutôt qu'un simple moyen de brûler des calories.
Dans cette quête, la méditation et la pleine conscience trouvent leur place, offrant un espace pour explorer les motivations profondes derrière nos habitudes alimentaires et nos choix de vie. Une réflexion constante sur nos relations avec la nourriture, le corps et l'environnement crée une base solide pour des changements durables.
Enfin, la patience et l'acceptation de soi jouent un rôle crucial dans ce voyage. Perdre du poids ne devrait pas être un acte de lutte acharnée contre son propre corps, mais plutôt une expression d'amour et de respect envers soi-même. Chaque étape du chemin, qu'il s'agisse de petites victoires ou de moments plus difficiles, devrait être accueillie avec compassion.
Retrouver une bonne forme devient alors un processus de croissance personnelle, une exploration constante de ce que signifie être en harmonie avec soi-même. En adoptant cette philosophie, on embrasse la santé comme un état d'équilibre global, où la beauté réside dans la compréhension profonde et la célébration de soi-même.
Profitez bien des journées lumineuses qui rallongent.
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails
Chère clientèle,
En cette période de changements et d'incertitudes, nous tenons à vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année à venir. En tant que pharmacien, notre engagement envers votre santé et votre bien-être reste notre priorité absolue.
L'année 2024 s'annonce comme une période pleine de promesses et d'opportunités, malgré les défis auxquels le monde est confronté. Nous croyons fermement que chaque jour est une nouvelle chance de trouver du plaisir et du bonheur, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours vers une vie plus saine et épanouissante.

Votre confiance est notre plus grande récompense, et nous continuerons à travailler avec dévouement pour vous offrir des solutions de santé adaptées à vos besoins. Que ce soit en prévention, en traitement ou en conseils, notre équipe de professionnels reste à votre disposition pour vous soutenir dans votre quête de bien-être.
N'oublions pas que la santé est un trésor précieux, et nous sommes honorés de faire partie de votre démarche pour la préserver. Ensemble, faisons de 2024 une année de réussites, de découvertes et de moments heureux.
Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et nous sommes impatients de partager cette nouvelle année avec vous.
Meilleurs vœux de santé et de bonheur,
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails
Soyons honnêtes, l'hiver est comme ce cousin éloigné que vous ne voyez qu'une fois par an, mais que vous attendez avec impatience. Il arrive sans crier gare, déposant sa magie glaciale sur tout ce qu'il touche. Alors, sortons nos écharpes, préparons nos réserves de chocolat chaud, et préparons-nous à accueillir cette saison extraordinaire.

Certains diront que l'hiver est sombre et froid, mais nous, les optimistes, savons qu'il est temps de briller de notre propre lumière intérieure. Laissez-moi vous convaincre que l'arrivée de l'hiver est en réalité la meilleure chose qui puisse arriver à votre santé, tant psychique que physique.
Commençons par la santé psychique. L'hiver est comme une excuse géante pour emmitoufler nos soucis dans des couches de couvertures et les laisser fondre sous le soleil d'hiver. Les journées plus courtes ? Pff, c'est juste une excuse pour passer plus de temps à contempler la beauté de la nuit étoilée et à faire des plans pour conquérir le monde au printemps.
Et parlons de la neige, cette substance magique qui transforme le monde en un royaume de conte de fées. Les flocons tombent doucement du ciel, recouvrant tout d'un manteau blanc et douillet. C'est comme si la nature elle-même nous lançait des confettis pour célébrer notre endurance tout au long de l'année. La neige, c'est le bonheur qui tombe du ciel !
Maintenant, passons à la santé physique. Qui a besoin d'une salle de sport quand on peut faire du patin à glace sur le trottoir verglacé ? L'hiver est un entraînement en soi. Marcher sur des trottoirs glissants, esquiver des congères et se frayer un chemin à travers la tempête de neige sont des exercices dignes d'un champion olympique.
Et n'oublions pas la résistance naturelle au froid. Votre corps devient une machine bien huilée, capable de braver les vents glacés sans broncher. C'est comme si vous aviez soudainement acquis des superpouvoirs anti-gel !
Alors, chers lecteurs, accueillons l'hiver à bras ouverts. Mettons nos bonnets les plus fantaisistes, enfilons nos moufles les plus douillettes, et préparons-nous à affronter les tempêtes de boules de neige de la vie. L'hiver est là pour nous rappeler que, peu importe la météo, le bonheur est une question de perspective. Alors, embrassons la saison froide avec un sourire radieux et préparons-nous à glisser joyeusement dans la nouvelle année !
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails
En cette saison automnale, nous sommes appelés à réfléchir sur la nature changeante du monde qui nous entoure. Les feuilles tombent, les jours raccourcissent, et avec l'arrivée du froid, la grippe saisonnière devient une réalité incontournable. Cependant, au lieu de succomber à la fatalité, nous sommes invités à méditer sur un acte de sagesse et de prévoyance - la vaccination contre la grippe.

La Connaissance comme Arme
Les philosophes de l'Antiquité nous ont enseigné que la connaissance est une arme puissante pour naviguer dans un monde complexe. De même, dans le domaine médical, la connaissance et la science nous ont donné l'opportunité de lutter contre la grippe, une maladie qui peut être grave, voire mortelle. Le vaccin grippe, fruit de la recherche scientifique, est notre outil de prévoyance.
Le Principe d'Éthique
Les philosophes contemporains nous rappellent l'importance de l'éthique, de la bienveillance et du respect envers autrui. Se faire vacciner contre la grippe n'est pas seulement un acte de prévoyance individuelle, c'est aussi un acte de solidarité envers ceux qui sont plus vulnérables, comme les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées.
La Liberté et la Responsabilité
Les penseurs modernes nous mettent en garde contre la tentation de confondre la liberté avec l'irresponsabilité. Chacun a le droit de décider de se faire vacciner, mais ce choix implique une responsabilité envers soi-même et envers la société. La vaccination contre la grippe est un moyen de préserver notre propre santé tout en contribuant à la protection de la communauté.
Conclusion
En fin de compte, la vaccination contre la grippe est un acte philosophique, ancré dans la connaissance, l'éthique, la solidarité, la liberté et la responsabilité. Au lieu de considérer la vaccination comme une simple procédure médicale, nous pouvons la voir comme une expression de notre humanité et de notre engagement envers le bien-être collectif.
Alors, cet automne, méditons sur le rôle du vaccin contre la grippe dans notre vie, et faisons le choix éclairé de la prévoyance et de la santé. Pour nous-mêmes, pour nos proches et pour la société.
Restez sages, prévoyants et en bonne santé.
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails
1. La modération : Suivez le principe de la modération de Socrate. Évitez les régimes draconiens et les privations excessives. Adoptez plutôt une alimentation équilibrée.
2. La connaissance de soi : Comprenez pourquoi vous voulez perdre du poids. Est-ce pour votre santé ou pour des pressions extérieures ? L'examen de vos motivations peut vous guider vers des objectifs plus authentiques.
3. Le stoïcisme : Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Le poids perdu peut revenir, mais la façon dont vous réagissez à cela est sous votre contrôle. Pratiquez la résilience.
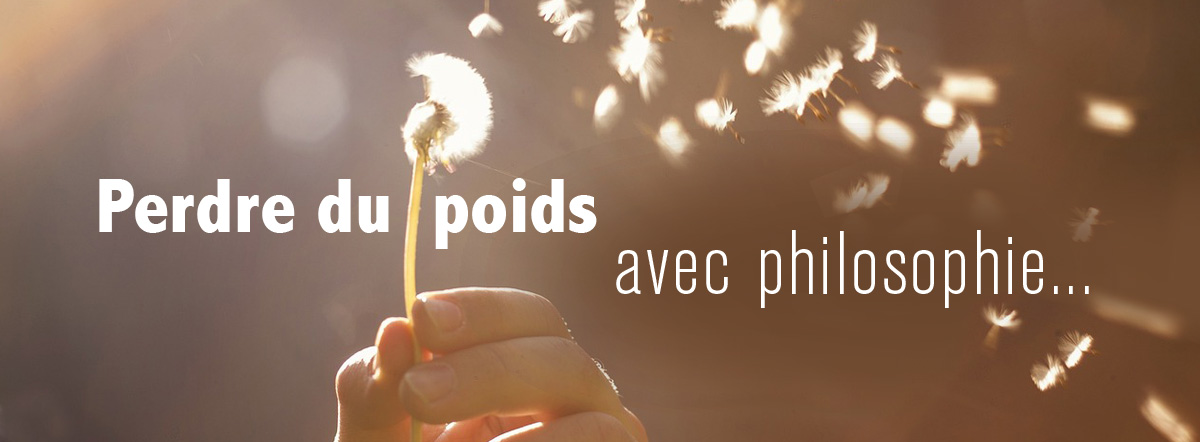
4. L'épicurisme : Recherchez le plaisir dans une alimentation saine. Appréciez les aliments nutritifs et savoureux plutôt que de vous priver de tout.
5. La pleine conscience : Pratiquez la pleine conscience en mangeant. Soyez conscient de chaque bouchée, cela peut vous aider à manger moins.
6. L'exercice philosophique : Considérez l'exercice comme une exploration de vous-même. Trouvez une activité physique qui vous plaît et qui vous connecte à votre corps.
7. L'équilibre : Trouvez l'équilibre entre le corps et l'esprit. La philosophie peut vous aider à comprendre que la santé mentale et physique sont interdépendantes.
Rappelez-vous que la perte de poids durable prend du temps, de la patience et de la réflexion. Consultez un professionnel de la santé pour élaborer un plan adapté à vos besoins spécifiques.
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails

Les arbres, une à une, se parent de feuilles d'or, de cuivre et de rubis, comme s'ils célébraient une fête invisible. Les feuilles, éblouissantes sous la lumière douce du soleil, virevoltent gracieusement dans les airs avant de se poser avec délicatesse sur le sol, créant un tapis artistique. Marcher sur ce tapis croustillant, les feuilles froissées sous nos pas, évoque une symphonie mélodieuse de l'automne.
Les vergers abondent de trésors à récolter. Les pommes, juteuses et sucrées, et les poires, douces et parfumées, s'accrochent aux branches, attendant d'être cueillies pour enchanter nos papilles. Les étals des marchés débordent de courges aux formes variées, attendant d'être transformées en soupes chaudes et réconfortantes. Les saveurs de l'automne nous rappellent la générosité de la nature et nous invitent à revenir à des plaisirs simples et authentiques.
Cette saison éveille également notre esprit créatif. Les décorations automnales ornent les porches, les citrouilles se transforment en lanternes éphémères, et les érables se parent d'un feuillage flamboyant. Les promenades en forêt deviennent des explorations poétiques, les rayons du soleil jouant à cache-cache avec les feuilles. L'automne nous pousse à sortir et à être présents dans le moment, à savourer les beautés fugaces et à créer des souvenirs durables.
Cependant, en cette saison de transition, il est essentiel de prendre soin de notre bien-être. Voici quelques recommandations pour une santé optimale pendant l'automne :
- 1. Alimentation équilibrée : Profitez des produits de saison tels que les fruits et légumes riches en vitamines et en antioxydants. Ils renforceront votre système immunitaire et vous aideront à rester en forme.
- 2. Hydratation : Même si les températures sont plus fraîches, n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau pour maintenir une hydratation adéquate.
- 3. Activité physique : Continuez à être actif, que ce soit par des promenades en plein air, du yoga ou d'autres exercices. L'activité physique régulière renforce non seulement votre corps, mais aussi votre esprit.
- 4. Sommeil de qualité : Profitez de la fraîcheur de l'automne pour vous envelopper dans des couvertures douces et obtenir un sommeil de qualité. Un bon sommeil est essentiel pour la santé physique et mentale.
- 5. Gestion du stress : Prenez le temps de vous détendre et de méditer. L'automne, avec sa sérénité, est propice à la réflexion et à la relaxation.
- 6. Prévention des maladies : Avec la saison des rhumes et des grippes, pensez à vous faire vacciner et à prendre des précautions d'hygiène pour éviter les infections.
- 7. Vitamine D : Étant donné que les journées raccourcissent, assurez-vous d'obtenir suffisamment de vitamine D en passant du temps à l'extérieur lorsque le soleil brille.
- L'automne est une saison de transition et de transformation. Profitez de sa beauté éphémère et prenez soin de votre santé pour aborder cette période avec énergie et vitalité.
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails
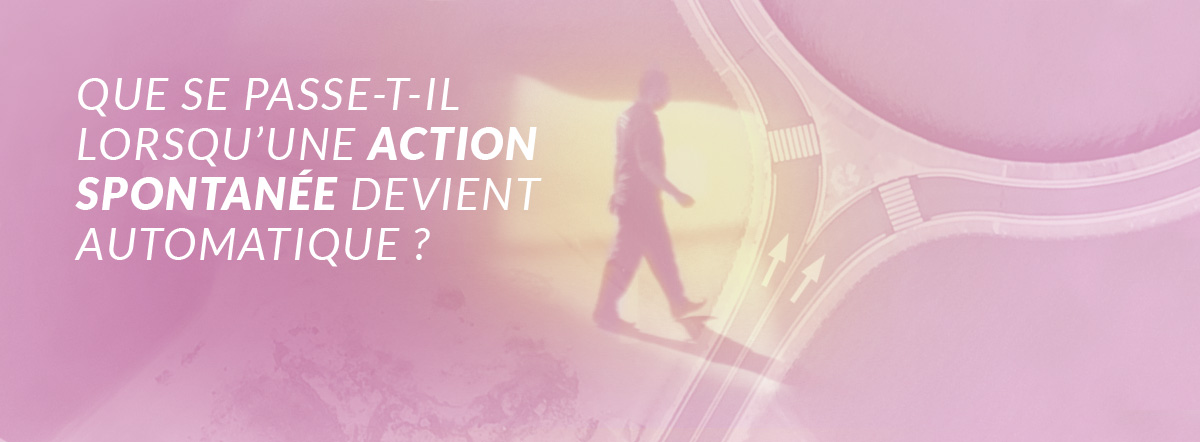
Dans l’apprentissage d’un exercice, par exemple, nous commençons par être conscients de chacun des mouvements que nous exécutons […] ; puis, à mesure que ces mouvements s’enchaînent davantage entre eux et se déterminent plus mécaniquement les uns les autres, nous dispensant ainsi de nous décider et de choisir, la conscience que nous en avons diminue et disparaît. Quels sont, d’autre part, les moments où notre conscience atteint le plus de vivacité ? Ne sont-ce pas les moments de crise intérieure, où nous hésitons entre deux ou plusieurs partis à prendre, où nous sentons que notre avenir sera ce que nous l’aurons fait ? […] Si conscience signifie mémoire et anticipation, c’est que conscience est synonyme de choix. »
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails

Premièrement, certains soutiennent que l’homéopathie offre une approche plus douce et moins invasive par rapport à la médecine conventionnelle. Les médicaments homéopathiques sont généralement préparés à partir de sources naturelles telles que les plantes, les minéraux et les produits animaux, et sont souvent dilués à des niveaux où il ne reste pratiquement aucune molécule active. Cette dilution est censée augmenter la puissance curative du médicament tout en réduisant les effets secondaires indésirables. Pour les personnes préoccupées par les effets secondaires potentiellement graves des médicaments conventionnels, l’homéopathie peut sembler une option plus sûre.
Bonne été !
Christian Cordt-Moller, Pharmacien responsable FPH / propriétaire
- Détails

« La mort est un trou noir. S’en approcher trop près, c’est courir le risque d’y être englouti et de ne pouvoir en parler » Frédéric Nef. Que dire de plus si l’on veut déterminer les caractéristiques de la mort, sinon qu’elle est à la fois quelque chose d’universel - puisque personne n’y échappe - et de subsistant - puisqu’elle demeure tout en emportant chacun dans le néant ?
Christian Cordt-Moller, Pharmacien FPH / propriétaire



